
Pendant les Jeux Olympiques, Paris et sa région seront la vitrine internationale du sport. Cependant, cet événement d’envergure présente des défis logistiques majeurs, notamment en matière de circulation dégradée et de restrictions d’accès. Le risque est bien réel de voir les commerces et les entreprises de Paris paralysés car coupés de leurs flux de transport habituels. La sortie de route nous attend, si les pouvoirs publics comme les transporteurs ne soignent pas davantage leurs trajectoires.
Un des principaux leviers pour les transporteurs, poussé par les pouvoirs publics et la préfecture de police, est l’expansion de l’utilisation des vélos cargos qui, tout en offrant une meilleure accessibilité aux centres urbains, zones congestionnées et bientôt inaccessibles aux véhicules motorisés, représente un mode de livraison plus respectueux de l’environnement.
Cependant, la transition vers le vélo-cargo n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît. Elle représente bien plus qu’un simple changement de véhicule, et nécessite en réalité un système logistique complexe et intégré, comprenant la mise en place de hubs de distribution spécialisés, où les cargaisons peuvent être reconditionnées pour le transport à vélo. Des ateliers de réparation dédiés pour maintenir les flottes en bon état de fonctionnement doivent être montés. Elle implique aussi une évolution radicale de la politique RH de l’entreprise, entre les profils de recrutement, les méthodes de formation ou la rémunération des salariés.
Néanmoins, la livraison en vélo-cargo (la “cyclo-logistique”) n’est pas la réponse unique aux défis de la livraison de demain, malgré la vision idyllique de certains acteurs. La cyclo-logistique est très adaptée pour une livraison standard, un colis léger partant d’un entrepôt centralisé et à destination d’une zone urbaine densément peuplée avec une exigence de service à la livraison limitée à “Sourire, Bonjour, Au Revoir, Merci” (SBAM).
Les entreprises ont des besoins de transport et logistique bien plus complexes, impliquant plusieurs types de marchandises (volumineuses, fragiles, température dirigée, etc.), ainsi qu’une diversité des points d’enlèvement et de livraison reliant le cœur de Paris, sa banlieue, la France et le reste du monde. La cyclo-logistique ne deviendra une option crédible pour les entreprises qu’au sein d’un ensemble de moyens de transport et de logistique intégrés et modulaires, pensé pour la diversité des flux de livraison.
Que ce soit dans le cadre des JO ou bien des futures réglementations urbaines, ...

Pendant les Jeux Olympiques, Paris et sa région seront la vitrine internationale du sport. Cependant, cet événement d’envergure présente des défis logistiques majeurs, notamment en matière de circulation dégradée et de restrictions d’accès. Le risque est bien réel de voir les commerces et les entreprises de Paris paralysés car coupés de leurs flux de transport habituels. La sortie de route nous attend, si les pouvoirs publics comme les transporteurs ne soignent pas davantage leurs trajectoires.
Un des principaux leviers pour les transporteurs, poussé par les pouvoirs publics et la préfecture de police, est l’expansion de l’utilisation des vélos cargos qui, tout en offrant une meilleure accessibilité aux centres urbains, zones congestionnées et bientôt inaccessibles aux véhicules motorisés, représente un mode de livraison plus respectueux de l’environnement.
Cependant, la transition vers le vélo-cargo n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît. Elle représente bien plus qu’un simple changement de véhicule, et nécessite en réalité un système logistique complexe et intégré, comprenant la mise en place de hubs de distribution spécialisés, où les cargaisons peuvent être reconditionnées pour le transport à vélo. Des ateliers de réparation dédiés pour maintenir les flottes en bon état de fonctionnement doivent être montés. Elle implique aussi une évolution radicale de la politique RH de l’entreprise, entre les profils de recrutement, les méthodes de formation ou la rémunération des salariés.
Néanmoins, la livraison en vélo-cargo (la “cyclo-logistique”) n’est pas la réponse unique aux défis de la livraison de demain, malgré la vision idyllique de certains acteurs. La cyclo-logistique est très adaptée pour une livraison standard, un colis léger partant d’un entrepôt centralisé et à destination d’une zone urbaine densément peuplée avec une exigence de service à la livraison limitée à “Sourire, Bonjour, Au Revoir, Merci” (SBAM).
Les entreprises ont des besoins de transport et logistique bien plus complexes, impliquant plusieurs types de marchandises (volumineuses, fragiles, température dirigée, etc.), ainsi qu’une diversité des points d’enlèvement et de livraison reliant le cœur de Paris, sa banlieue, la France et le reste du monde. La cyclo-logistique ne deviendra une option crédible pour les entreprises qu’au sein d’un ensemble de moyens de transport et de logistique intégrés et modulaires, pensé pour la diversité des flux de livraison.
Que ce soit dans le cadre des JO ou bien des futures réglementations urbaines, telles que les ZFE, les contraintes logistiques et les restrictions de circulation imposées vont forcer les acteurs de la livraison à innover rapidement pour s’adapter aux nouvelles conditions d’exercice de leur métier et à étoffer leurs offres avec de nouveaux services. Concilier l’élargissement des offres avec le maintien de la lisibilité et de l’efficacité opérationnelle passera par la modularisation des services proposés, la formation des équipes et l’adoption de technologies adaptées pour répondre à des conditions opérationnelles dégradées.




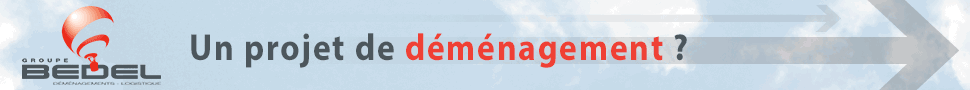


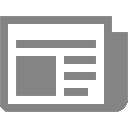 Chroniques
Chroniques
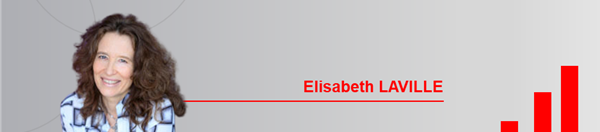

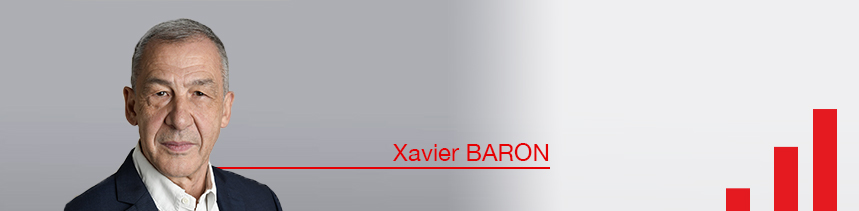
 Les valeurs de l’olympisme semblent peu diffuser en France actuellement…
Lorsque l’on parle des Jeux Olympiques qui arrivent, on sent rarement un enthousiasme débordant ; nombre de personnes voyant davantage les difficultés potentielles (coût financier, craintes en matière de sécurité…) qu’un moyen de voir rayonner les valeurs de l’olympisme dans notre pays.
Et cependant, les valeurs de l’olympisme sont plus que jamais nécessaires…
Les trois valeurs de l’olympisme, à savoir l’amitié, le respect et l’excellence sont plus que jamais nécessaires.
L’amitié est ce qui permet aux personnes de réussir ensemble parce que ce qui les unit est plus fort que ce qui les différencie. « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » disait Antoine de Saint-Exupéry.
Le respect est ce qui permet à des personnes différentes de se considérer et de...
Les valeurs de l’olympisme semblent peu diffuser en France actuellement…
Lorsque l’on parle des Jeux Olympiques qui arrivent, on sent rarement un enthousiasme débordant ; nombre de personnes voyant davantage les difficultés potentielles (coût financier, craintes en matière de sécurité…) qu’un moyen de voir rayonner les valeurs de l’olympisme dans notre pays.
Et cependant, les valeurs de l’olympisme sont plus que jamais nécessaires…
Les trois valeurs de l’olympisme, à savoir l’amitié, le respect et l’excellence sont plus que jamais nécessaires.
L’amitié est ce qui permet aux personnes de réussir ensemble parce que ce qui les unit est plus fort que ce qui les différencie. « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » disait Antoine de Saint-Exupéry.
Le respect est ce qui permet à des personnes différentes de se considérer et de... 

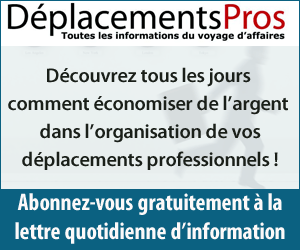
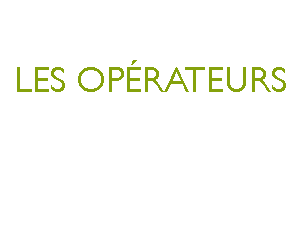
 inscription prestataires
inscription prestataires
 devenez annonceurs
devenez annonceurs
 nous contacter
nous contacter